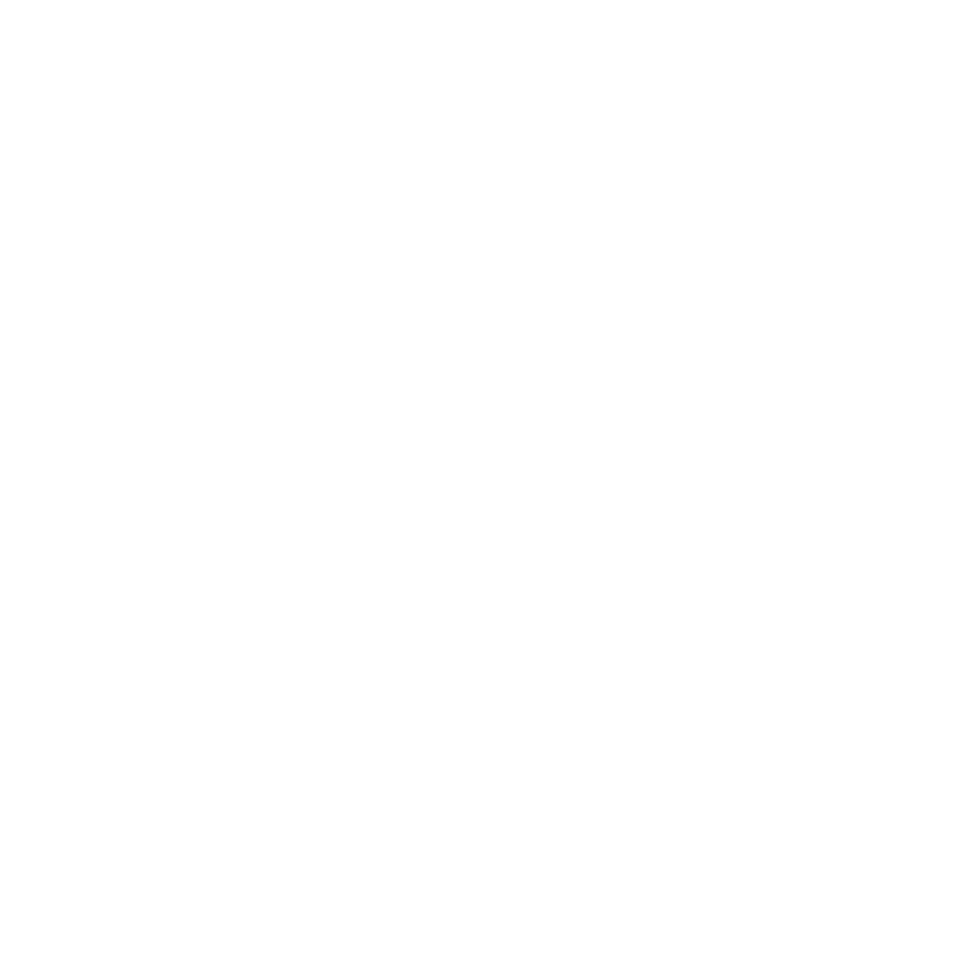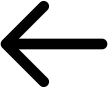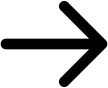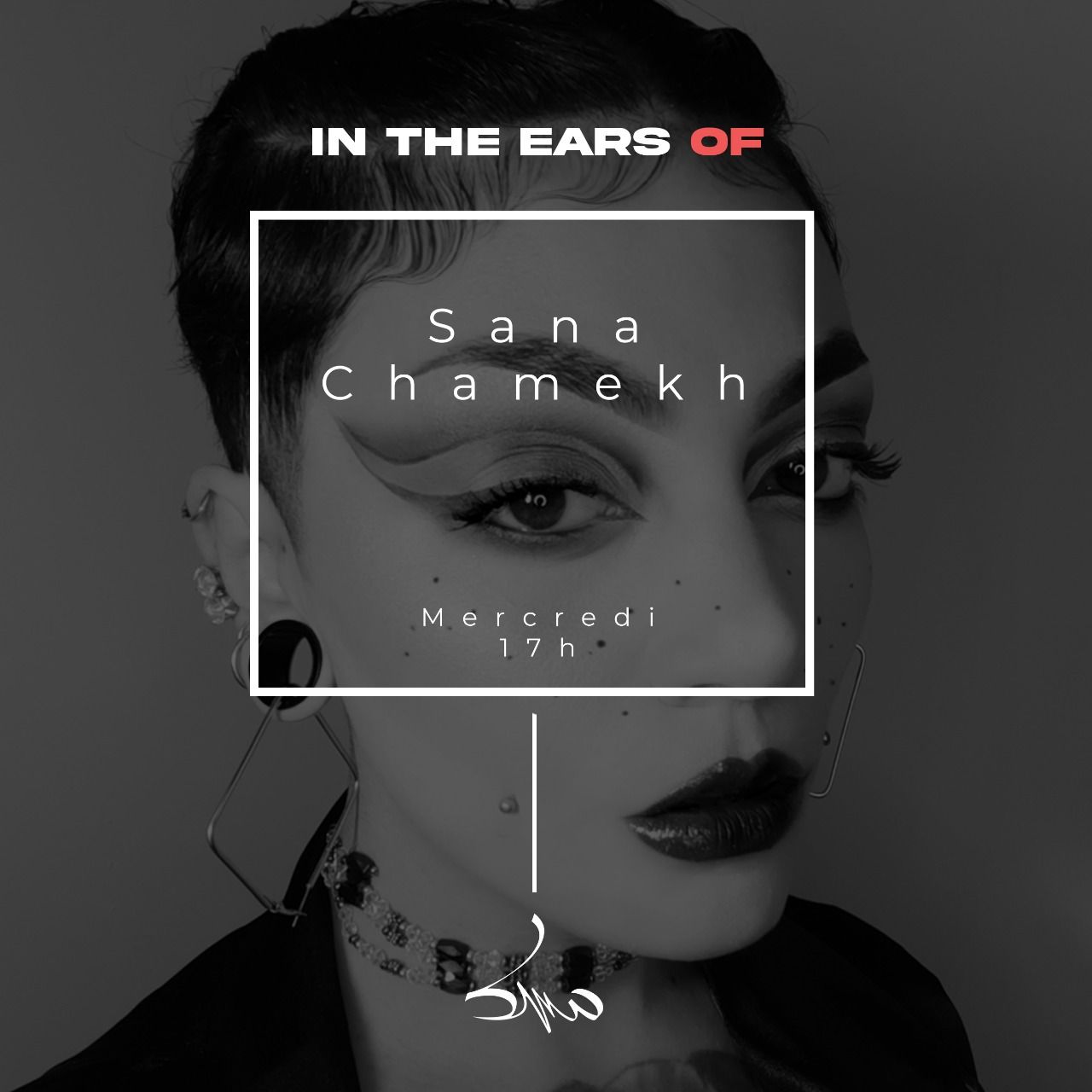Un jour, alors que son équipe venait d’échouer à marquer un but sur une parade magnifique du gardien adverse, j’ai vu un gardien de but -suspendu en l’occasion- s’extasier devant la prouesse de son alter ego, quoique rival, plus que de se lamenter du raté de ses coéquipiers. Pour couper court à toute supputation d’un hypothétique lecteur quant à savoir si le goal était celui de l’Étoile, du CSS ou autre, je précise que c’était le gardien de l’Olympiakos. Mais ç’aurait pu être celui de l’ASI Jebel-Jelloud que ç’aurait été pareil : la confrérie des gardiens est universelle -même si ça n’exclut pas les vacheries ou rivalités personnelles.
La corrélation entre ce poste de gardien et les hommes de lettres qui ont pratiqué le sport est étonnante. Henry de Montherlant, le premier auteur ‘moderne’ à se consacrer au sport avec ‘Les Olympiques’, fut gardien de but (même s’il consacra un poème à l’ailier). Un biographe de François Mitterand (goal en sport scolaire puis universitaire pour l’équipe de son lycée puis en cours préparatoire) mentionnait que le poste lui permettait de réfléchir, tout en surveillant l’action de loin. Il est vrai qu’aucun sport n’offre un rôle aussi caractéristique, ni aussi crucial, ni aussi distinct des autres athlètes-partenaires, et comme « tout artiste désire être reconnu » ainsi que le disait un autre gardien de but dont nous reparlerons, le poste convient parfaitement. À part pour Pier-Paolo Pasolini, qui jouait en tant qu’attaquant, mais lui voulait déjà se démarquer de ceux qui se démarquent. D’ailleurs à part le hockey ou le handball, aucun sport ne comporte de gardien de but, et dans ces deux derniers sports, les gardiens sont déjà beaucoup plus près de l’action, surtout ceux du hand qui ramassent une cinquantaine de tirs à bout portant avec des balles aussi lourdes que des ballons de foot, en plus d’être pleines de résine et plus petites.
Plus près de nous, l’un des meilleurs exemples de sportif de haut niveau et homme de culture fut sans doute Mohamed Ayachi, lui aussi dernier défenseur footballistique. Attouga, le meilleur gardien tunisien de l’histoire à ce jour, l’a défini comme son modèle. Gardien exceptionnel, capable d’arrêter un tir de la tête en match international (au point de provoquer la fureur du tireur adverse qui s’estimait moqué), Ayachi fut d’un tel courage physique qu’il fut souvent blessé. Sa carrière sportive en pâtit, lui qui privilégia de toute façon toujours sa passion pour la musique et la littérature au sport. Au point que son parcours sportif fut d’ailleurs toujours subordonné à sa carrière académique : il ne démarra le sport de haut niveau qu’à vingt ans, migra du Stade soussien au Club africain dans la foulée de ses études de littérature et revint à Sousse une fois sa carrière d’enseignant entamée dans la perle du Sahel. Luthiste chevronné, ayant tâté de la musicologie, il fit mieux que d’étudier la littérature et de l’enseigner, écrivant des poèmes et reconnu au point d’être publié -longtemps après avoir raccroché les gants. D’ailleurs, c’est la conjonction des deux talents qui lui valut un surnom glané au Caire. Le 19 février, en lice face à l’Égypte pour se rendre aux Jeux Olympiques de Rome, il écœura à lui seul l’attaque adverse durant la première période, maintenant un score vierge qui valait de l’or. En sa qualité d’enseignant, Mohamed Ayachi fut qualifié de ‘Cheikh’ par le reporter égyptien. Celui-ci mentionna aussi la baraka impressionnante dont le cheikh-goal avait fait preuve. Il devint tout simplement ‘Cheikh Baraket’. Nos adversaires, tout en finesse, usèrent eux aussi de culture pour l’emporter 3-1 au final. Ils firent entrer Abdelhalim Hafedh dans le vestiaire tunisien durant la mi-temps. Tous les joueurs, staff, accompagnateurs, qui avaient fait bloc de façon héroïque en première période, s’empressèrent de se déconcentrer pour aller poser avec le Rossignol Brun (tous sauf le benjamin de la sélection, Abdelmajid Chetali, qui leur passa un savon après du haut de ses vingt ans. La valeur n’attend pas le nombre des années…). Bref. Au retour, Noureddine Diwa, leader de la sélection, fut blessé après quelques minutes par un défenseur égyptien nommé Chaghabi, voyou des terrains et… peintre de son état. La culture n’est pas toujours le reflet du sport… La Tunisie se qualifia tout de même pour Rome, Diwa devint professionnel. Par contre, Mohamed Ayachi, dans le giron de la sélection, contracta la malaria et fut plus tard sanctionné sportivement de façon disproportionnée. Il lui restait fort heureusement bien d’autres nourritures spirituelles pour ne pas être amer à ce propos.
Le gardien de but cité plus haut, qui parlait du désir de reconnaissance de l’artiste, était celui du club algérois de l’AS Monpensier puis du Racing Universitaire d’Alger, Albert Camus. On lui doit une phrase (souvent estropiée et remaniée au gré des versions…) derrière laquelle se cachent souvent ceux qui veulent faire rimer sans trop se fatiguer football et culture (… donc je vais pas me gêner), « Vraiment le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront les vraies universités ». On pourrait ajouter que le gardien junior du RUA fit sympathiser les protagonistes de « La peste » par le biais du football, fit chanter le public de « L’étranger » un chant en faveur du Racing, et fit déclarer au narrateur de « La chute » (Jean-Baptiste Clamence ; mais ne nous y trompons pas, le roman est écrit à la première personne) : « Maintenant encore, les matchs du dimanche, dans un stade plein à craquer et le théâtre, que j’ai aimé avec une passion sans égale, sont les seuls endroits au monde où je me sente innocent » (NB : ça marche pour tous les jours de la semaine. Camus fut le généreux parrain au quotidien du club de sa ville de Lourmarin où il s’établit). Et quelques autres citations pleines de justesse quant au ballon rond. Mais l’amour du football fut pour le futur prix Nobel bien plus qu’une passion, souvent une planche de salut. Il lui permit, à lui l’enfant pauvre, boursier méritant et orphelin d’un père mort au front, de briser à longueur de récréations les barrières sociales que le ‘grand collège’ (devenu ensuite Lycée Bugeaud et aujourd’hui Lycée AbdelKader) pouvait dresser entre élèves de différentes conditions. Quant au poste de gardien, s’il lui permettait de se distinguer, il le fit sien pour deux raisons essentielles : ‘Bébert’ était parmi les plus petits de sa classe d’une part (il poussa vers ses quinze ans) ; et il évitait ainsi d’user trop vite des souliers pour lesquels manquaient les fonds d’autre part. Le choix du Racing Universitaire fut aussi logique : né dans une famille analphabète (son père apprit à écrire peu avant sa naissance), premier lycéen parmi les siens, viscéralement attaché à Alger (il suffit de le lire pour le ressentir), les diverses identités du RUA étaient celles du jeune homme. Que le Racing s’ouvre ensuite aux indigènes et soit mixte, à lui qui fut toujours d’une équité irréprochable au sein du mélange de populations que fut l’Algérie coloniale, ne fit que le parfaire dans son attachement au club, lui qui avoua avoir ressenti une émotion jusqu’à Buenos Aires à la seule évocation des initiales RUA.
Si Ayachi vainquit la malaria, séquelle du football, Albert Camus lui dut au football de dominer -sans pouvoir la vaincre totalement- la tuberculose : alors qu’il rêvait à une carrière de haut-niveau, sérieusement envisageable (son coéquipier Couard passa professionnel au Racing -de Paris- et fut champion de France), et qu’il gardait les bois du Racing (d’Alger), le jeune Albert s’écroula -en 1930- en pleine partie, inanimé. On put diagnostiquer et combattre correctement et en temps voulu le mal, et le jeune homme profita de sa convalescence pour assouvir une boulimie de lecture et d’écriture déjà bien établie, placé qu’il fut chez un oncle aisé et féru de littérature. Mais il ne rejoua plus jamais au même niveau (s’essayant à rejouer en 1940, il constata avoir pris dix ans… Il faut dire aussi qu’il joua en tant qu’attaquant). Il abandonna également l’idée d’enseigner, pour devenir journaliste et essayiste. Et le monde entier sait aujourd’hui avec quel talent il sut compenser le manque dû au football par des satisfactions littéraires. Nous permettant d’ailleurs à nous supporters de nous cacher aisément derrière lui lorsque l’opinion publique nous fait passer pour des brutes pour simplement aimer le sport avec passion.
Ce n’est pas par hasard que cette chronique parle d’Albert Camus et de football : elle est écrite un 4 janvier. Cette éphéméride correspond hélas à la disparition du prix Nobel algérois, ainsi qu’à celles, plus tard, de Hedi Berrekhissa et de Lassâad Ouertani, deux des footballeurs préférés du public (chacun pour ses couleurs). Elle correspond aussi à la prise en otage du peuple par le pain dans les luttes de succession de Bourguiba en 1984, mais l’objet de la chronique n’est pas celui-ci, pas plus que le match nul entre le Stade tunisien et le Club africain 0-0 le 4 janvier 1978 (au Zouiten, pour ceux qui veulent vraiment tout savoir). Mais je m’égare. Bref. Un jour qu’on l’interviewait à Colombes, à peine couronné du prix Nobel, en plein stade, où il venait de voir Monaco marquer grâce à une bévue monumentale du gardien du Racing (de Paris), Albert Camus dit qu’il avait pour lui « l’indulgence d’un confrère » et qu’il ne fallait « pas l’accabler. C’est quand on est au milieu des bois que l’on s’aperçoit que c’est difficile ». La confrérie des gardiens de but est universelle.