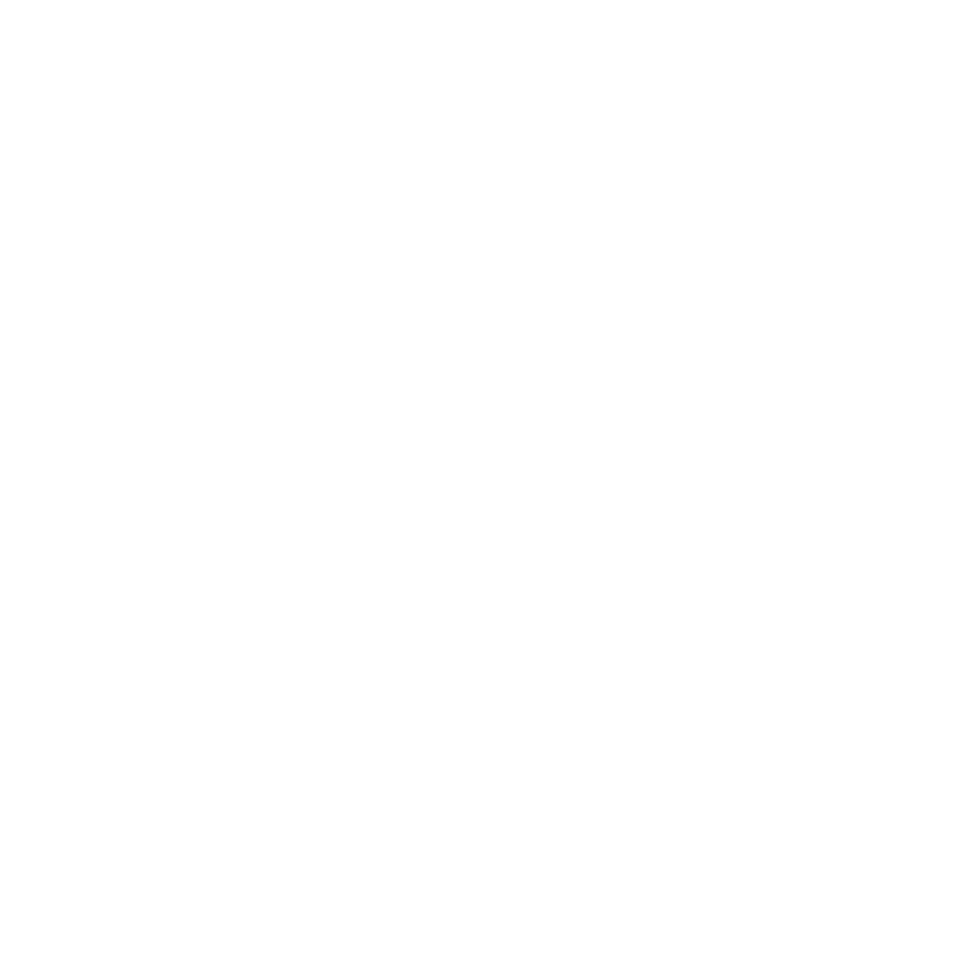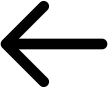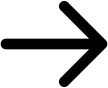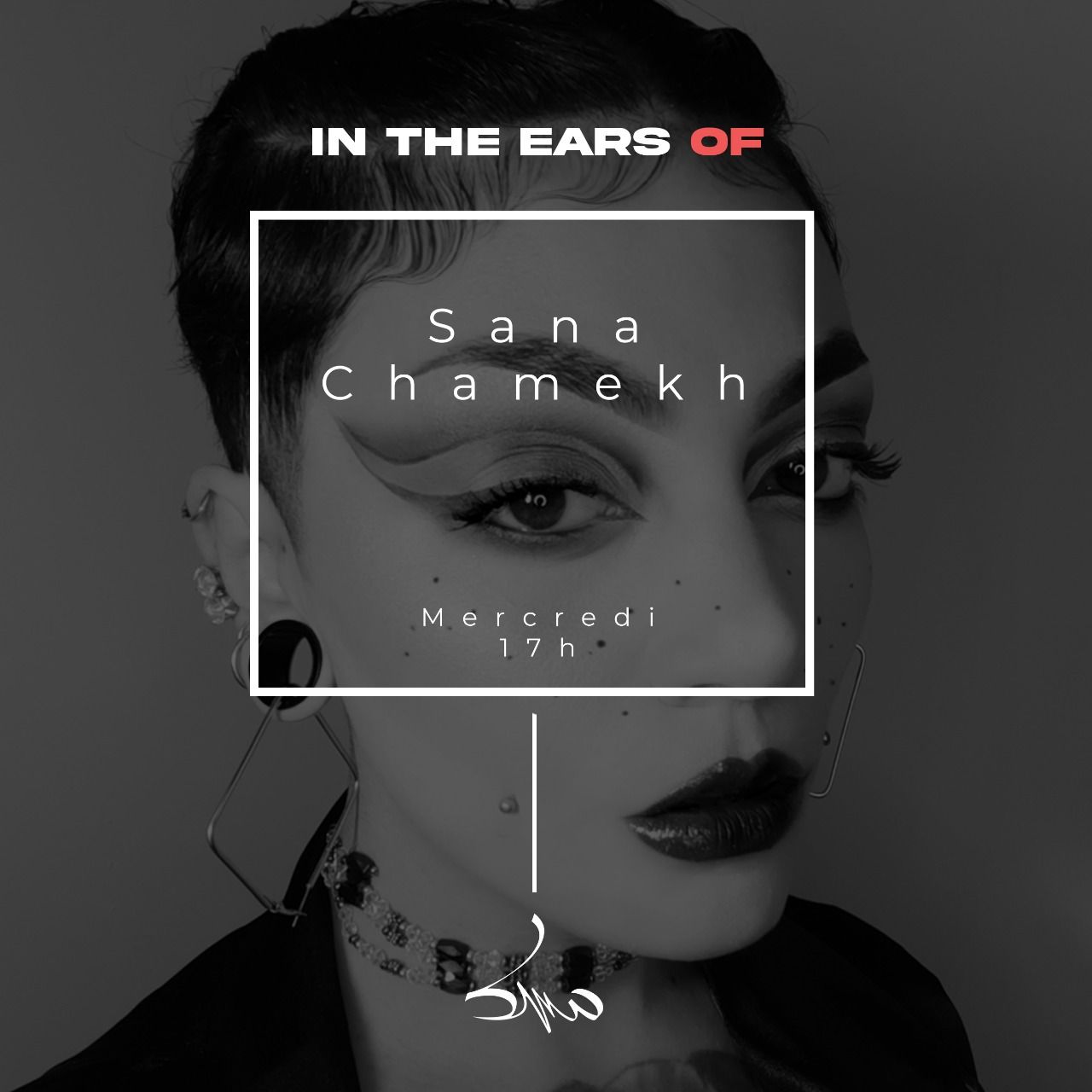Il s’agit là d’un vrai coup de cœur : Parasite de Bong Joon-Ho. C’est le film sud- coréen qui a remporté la palme d’or lors de la dernière session du festival de Cannes (2019) et ce, à l’unanimité du jury.
Le réalisateur sud- coréen de 50 ans, amateur de thrillers, signe avec ce film son septième long-métrage qui représente la quintessence de sa réflexion à un double niveau : les dérives du capitalisme, une thématique présente dans la plupart de ses films, et son refus de se plier aux moules narratifs offrant ainsi une œuvre difficilement étiquetable.
Quelles sont les pistes thématiques du film ?
On a un père de famille, Ki-taek, sa femme, Chung-sook, leur fils, Ki-woo et leur fille, Ki-jung. Tous sont au chômage, vivent dans une sorte de bunker délabré, n’aperçoivent par la fenêtre que les pieds des passants, piratent le réseau wi-fi des voisins pour rester « connectés » et survivent grâce au pliage de cartons de pizza.
Un jour, Ki-woo trouve un boulot grâce à un ami qui lui demande de le remplacer pour donner des cours particuliers en anglais à la fille des Park, une famille richissime. Ki-woo va tout faire pour introduire sa sœur chez les Park sans jamais révéler leur lien de parenté. La sœur, à son tour, fera tout pour que les Park engagent son père comme chauffeur. Une fois recrutés, Ki-taek et ses deux enfants monteront un stratagème pour se débarrasser de la gouvernante des Park. Chung-sook la remplacera. A partir de là, on va avoir 4 membres d’une même famille qui travaillent chez les Park sans que les Park ne soient au courant de leur lien de parenté.
Par instinct de survie, ils feront tout pour rester au service des Park jusqu’à leur perdition.
La violence des propos de Bong Joon-ho est visible au niveau de l’électrochoc provoqué par la découverte de l’autre et ce, dans une parfaite réversibilité. Si la famille de Ki-taek ne cherche qu’à manger à sa faim et avoir une vie décente, elle reste froide face à l’oisiveté et à la superficialité des occupations des Park.
Monsieur Park et son fils reconnaissent leurs nouveaux « employés » grâce à leur odeur spécifique pour laquelle ils montrent un certain dédain. La fissure entre les deux mondes est tellement bien décrite, dans le film, que le spectateur adopte tout de suite le point de vue du réalisateur par rapport aux écarts sociaux et par rapport à sa haine envers le système capitaliste. Le film est violent parce qu’il donne raison à la violence. C’est un dur portrait de la Corée du sud et de ses contradictions sociales.
La scène la plus marquante reste le soir du déluge. Les Park s’amusent dans leur grande villa avec leur fils qui imite les pompiers, et la famille de Ki-taek, garde à peine la tête au-dessus de l’eau dans son bunker inondé.
Leur fille, Ki-jung, grimpe auprès des toilettes placées sur une hauteur, à 50 centimètres du plafond. Elle s’assoit sur l’abattant pour éviter que les wc n’éjectent plus d’eau noire et de défections. Le bras levé, elle cherche désespérément le réseau pour rester malgré tout « connectée ».
Le mépris, l’injustice sociale, le sentiment d’être un sous-citoyen ou un sous- être humain à défaut d’avoir une vie décente, transforment les personnages et en font des bombes à retardement. Pourtant, tout reste construit dans la nuance.
Quels sont les risques narratifs adoptés par le réalisateur ?
On s’accorde sur un fait : l’entremêlement des genres dans ce film. On parle, d’abord, d’une comédie sociale qui ouvre le bal et qui va petit à petit devenir une comédie noire. Celle-ci va graduellement laisser la place au thriller puis à ce qui a été défini comme « film catastrophe ».
Effectivement, Bong Joon-ho jongle avec les règles narratives et laisse glisser sa fiction d’un genre à un autre dans une subtilité extrême induite non seulement par le retournement de situations mais également par le filmage. Ceci crée un suspense continu qui ne tombe jamais dans le systématisme de la surprise. Le spectateur est souvent pris au piège.
Cette maîtrise de l’interférence des styles place le film dans une absolue expressivité moderne qui brise les carcans du genre unique. Le réalisateur rejoint dans cela certains théoriciens littéraires qui, depuis une bonne vingtaine d’années, dénoncent les limites du genre.
La circulation entre la comédie sociale et le thriller ne fait qu’appuyer davantage son point de vue. Alarmiste, il pointe du doigt les conséquences possibles des injustices sociales. Le réalisateur va jusqu’au bout en mettant en scène un personnage devenu fou, tellement fou qu’il en perd toute sentimentalité. L’absurdité de la violence qui va s’en dégager est égale à l’absurdité de l’inégalité des chances dans une ville construite sur les hiérarchies.
D’ailleurs, dans ce sens, le réalisateur reprend une construction que nous avons pas mal vue dans les fictions : les gens d’en bas et les gens d’en haut. Même Titanic présente la même distinction entre deux classes sociales : les ouvriers sont en bas du bateau et les riches en haut. Cette séparation montre généralement combien les gens d’en bas restent humains et généreux même dans leur malheur et combien les gens d’en haut sont dans l’artifice. Bong Joon ho détourne la situation et évite ce cliché : Pour lui, aucune empathie n’est possible face au sentiment d’injustice. Tous les personnages sont condamnables.
Pourtant, avec un sujet aussi vif et un avis aussi dur, le réalisateur ne choisit guère, pour s’exprimer, l’option cinématographique tant aimée par les cinéastes européens, à savoir le naturalisme ou le réalisme cru. Bong Joon-ho reste dans une description très fluide avec un univers qui ne manque pas d’esthétisme et de poésie même si cette poésie s’avère noire.
Il n’y a, donc, ni caméra portée qui lèche les personnages ni des situations dramatiques où on palabre sans fin. Tout est dans la suggestion. Les personnages parlent peu et l’univers frôle parfois le fantastique.
Pourquoi ? Parce que cela permet de montrer, malgré tout, que l’injustice est surréaliste. Elle n’est pas un fait « normal », elle relève de l’incompréhensible. N’est-ce pas un coup de maître ?
Le film est à voir, c’est une pure merveille. Et le cinéaste nous réconforte avec sa vision cinématographique et avec son engagement qui lui a valu le titre de cinéaste politique.
Dans une ère où tout est politisé, de l’espace privé à l’espace public, les fictions modernes ne peuvent être que politiques. Nous dirons même que les grandes œuvres ne peuvent être produites par des « analphabètes politiques », qui selon Brecht, sont les pires des analphabètes…